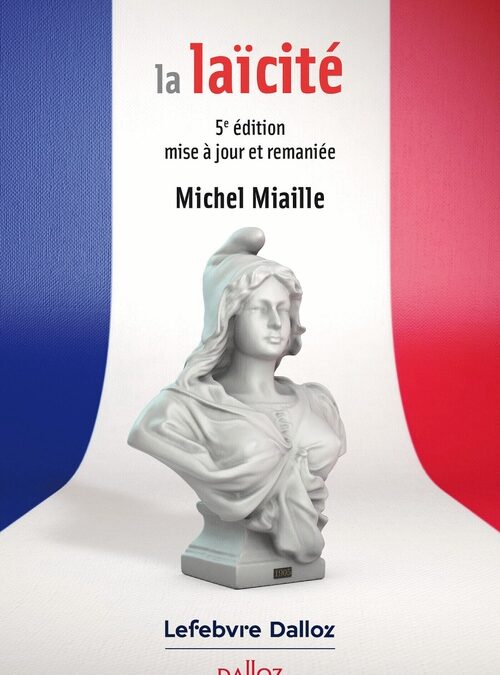Une recension de Jacques Limouzin, médiéviste, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional d’histoire-géographie, doyen de l’inspection, académie de Montpellier, co-auteur de « Une histoire européenne de l’Europe » (Privat) et directeur de « Regards sur le patrimoine » (SCEREN).
Une recension de Jacques Limouzin, médiéviste, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional d’histoire-géographie, doyen de l’inspection, académie de Montpellier, co-auteur de « Une histoire européenne de l’Europe » (Privat) et directeur de « Regards sur le patrimoine » (SCEREN).
C’est la cinquième édition d’un ouvrage « La Laïcité » qui est désormais et sur son sujet, un classique. Mais une cinquième édition largement remaniée et surtout actualisée par les derniers débats : c’est bien de la « laïcité 2025 » dont il s’agit. Avec un prix minime: quatre €.
Dans l’introduction, l’analyse de la complexité des origines du mot engage le débat. Et la plongée dans l’histoire, à partir des tentatives réitérées des sociétés pour « donner du sens au lien social et au lien politique » éclaire les avatars de la relation entre les pouvoirs civils et les religions. Si la Révolution « opère une profonde rupture dont l’essentiel réside dans l’idée de liberté », il faut attendre la fin du XIXe siècle, pour que « la solution laïque, [puisse] enfin apparaître comme la solution ».
Mais pas n’importe laquelle : une loi de compromis, née de l’habileté d’Aristide Briand, est suivie d’une non moins prudente mise en œuvre. Pour l’auteur, l’acceptation assez large du principe de laïcité et sa constitutionnalisation en 1946 créent une configuration qui éclate à la fin du XXe siècle, redistribuant les positionnements à droite, comme à gauche. L’auteur laisse clairement entendre qu’il est surpris de ce que la laïcité soit désormais convoquée à propos de problématiques issues d’évolutions planétaires qui la dépassent et notamment « pour donner des solutions qui rétabliraient l’autorité de l’État, la paix sociale et l’unité du pays. Rien de moins ! » Le ton étant donné, on comprend lors le propos de son ouvrage qui consiste à « remettre la laïcité à sa place, dans la République, comme principe organisateur des institutions et régulateur des pratiques des citoyens et de l’Administration dans le domaine de la liberté de pensée et de culte, et conséquemment des pratiques qu’elle autorise dans l’espace public. »
Le lecteur, plongé jusque-là dans le maelström dévergondé qui fait aujourd’hui bouillonner les débats sur « la » laïcité découvre alors ce propos structurant de la réflexion du professeur Michel Miaille avec le sentiment du naufragé qui voit apparaître au loin… un rivage.
La première partie de l’ouvrage décrit « Le principe de laïcité au regard des textes ». Ce n’est pas un détour. L’auteur, juriste et politiste qui ne renie pas ses racines intellectuelles, justifie sa volonté de fonder sa réflexion sur les masses de granite des textes de références. On se félicite de les trouver tous, dans leur détail lorsque c’est nécessaire, et avec les commentaires qui les éclairent. Enfin, se dit-on, un point de départ solide et sérieux pour parler d’un principe de droit. Plus solide évidemment que les sentiments, croyances, désirs ou certitudes de chacun, tous respectables certes, mais relevant de la subjectivité au sens des désirs des sujets qui s’expriment.
Cet examen des textes se clôt sur les inflexions que l’auteur décèle dans les derniers d’entre eux et notamment dans la loi du 24 août 2021. Sommes-nous en train de changer de paradigme? Le primat de la liberté, consubstantiel à la loi de 1905 est-il désormais mis en cause ? Voilà qui mérite débat et l’on ne peut que remercier l’auteur d’en clarifier les termes.
Ayant franchi les Colonnes d’Hercule des textes, le lecteur peut alors naviguer avec une forme de bonheur dans une approche rare de la question : « Le principe de laïcité dans les pratiques sociales quotidiennes ». Une approche rare et infiniment séduisante puisque c’est du réel de la vie qu’il est question : vie privée « domestique », vie de l’entreprise et vie des services publics. On retrouve ici la problématique initiale : quelle est la place de la laïcité dans ces continents de la vie sociale ? Tout ce qu’il y a de concret, tout ce qu’un individu peut rencontrer au jour le jour, voire heure par heure, est soumis à l’examen, les personnes, les cultes, les vêtements, les signes, les entreprises, la santé, les fêtes… etc. C’est de la laïcité in vivo et non in abstracto qu’il est question. Des situations réelles, clairement référées aux textes réglementaires et aux textes de la jurisprudence. À ce titre l’ouvrage prend le statut et rend le service d’un manuel pratique pour affronter les questions que chacun, citoyen, agent public ou élu peut se poser chaque jour.
Il reste à louer la langue claire d’un juriste qui sait écrire pour tout le monde, et même pour ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, ne font pas tombés tout petits dans la marmite du droit. Ceux-là peuvent découvrir que le droit donne beaucoup de réponses aux questions que l’on se pose. Avec les interrogations de la conclusion, ils peuvent prendre conscience que le principe de liberté qui irrigue la laïcité française depuis 1905 mérite d’être défendu. Et ils peuvent voir que, page à page, Michel Miaille répond à sa question initiale sur ce qui relève vraiment de laïcité dans chacune des questions concrètes abordées.
Jacques Limouzin.